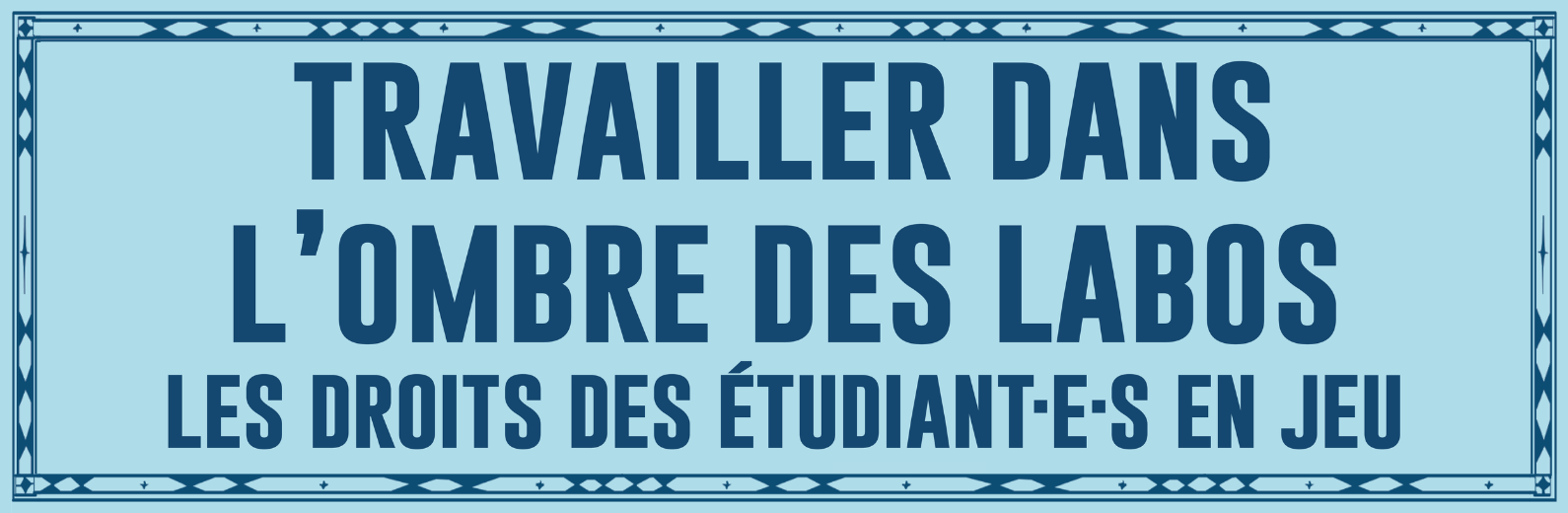Le 29 novembre : toutes et tous dans la rue pour faire front !
Le gouvernement Legault s’en prend frontalement à nos droits et à nos acquis sociaux. Des attaques sans précédent exigent une réponse sans équivoque de la part des syndiqués et de la population solidaire. Le samedi 29 novembre 2025, joignons nos forces dans la rue pour défendre nos conditions de travail, notre pouvoir collectif et la justice sociale. Ensemble, faisons front commun contre l’austérité et la casse sociale!
Nous refusons de rester les bras croisés pendant que ce gouvernement sert les intérêts des patrons et alimente la machine de la privatisation, au lieu de répondre aux besoins réels de la population. Chaque dollar coupé dans l’éducation, la santé ou les programmes sociaux nous vole un peu de notre bien commun – c’est une véritable dépossession collective de nos acquis. En parallèle, le gouvernement mène une offensive coordonnée pour museler les syndicats et criminaliser la contestation. Plusieurs projets de loi récents – dont les projets de loi 89, 101 et 3 – s’attaquent directement à notre capacité d’agir collectivement :
- Le projet de loi 89 confère des pouvoirs exceptionnels au gouvernement qui pourraient s’appliquer à presque tous les secteurs. En cas de grève ou de lock-out, le Tribunal administratif du Travail (TAT) pourra, à la demande du ministre, imposer le maintien de « services minimalement requis » pour éviter qu’une grève n’affecte « de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population ». Ce critère très large (sécurité sociale ou économique de la population) ouvre la porte à l’imposition de services essentiels bien au-delà des secteurs traditionnellement jugés vitaux. Le simple fait qu’une grève puisse déranger l’économie devient un prétexte pour la restreindre. Cette logique ouvre la porte à une neutralisation complète du droit de grève : si la moindre perturbation économique est jugée « disproportionnée », alors plus rien n’est possible. C’est un recul historique qui transforme un droit fondamental en permission conditionnelle, accordée seulement quand il ne dérange pas les patrons.
- Le projet de loi 101, déposé au printemps 2025 par le ministre Boulet, était présenté comme un « perfectionnement » du cadre légal existant, touchant notamment la lutte aux briseurs de grève et la santé-sécurité au travail. En théorie, le PL 101 visait à moderniser les normes du travail pour les adapter aux réalités actuelles et renforcer la transparence et l’équité dans les relations de travail. Cela dit, plutôt que d’encadrer réellement les employeurs et de protéger les salarié·es, il s’attaque surtout aux organisations syndicales en leur imposant des obligations financières accrues, tout en laissant les associations patronales tranquilles. Les mesures contre les briseurs de grève sont largement insuffisantes, surtout à l’ère du télétravail, où la loi continue de permettre des remplacements déguisés sans sanction sérieuse. Pire encore, il augmente massivement les amendes imposées aux travailleur·euses et syndicats, tout en ménageant les employeurs. Le message est clair : punir les salarié·es qui se défendent, protéger celles et ceux qui brisent la solidarité.
- Le projet de loi 3 introduit, quant à lui, une série de règles administratives contraignantes encadrant la vie syndicale de façon sans précédent. Parmi les dispositions principales :
- Les cotisations des membres seraient scindées en deux volets distincts – une cotisation de base réservée aux activités syndicales strictement liées aux relations de travail (négociation, application des conventions, services aux membres, etc.), et une cotisation facultative pour financer toutes les autres activités (campagnes publicitaires, interventions politiques ou sociales, appuis à des mouvements sociaux, contestations judiciaires de lois, etc.). Toute dépense à des fins « politiques ou sociales » payée à même la cotisation régulière deviendrait illégale, passible d’amendes allant de 5 000 $ à 50 000 $. En pratique, cela signifie qu’un syndicat ne pourrait plus utiliser la cotisation régulière pour, par exemple, contester une loi spéciale en justice ou participer à une campagne publique sur un enjeu de société touchant ses membres. Il lui faudrait au préalable créer un fonds spécial alimenté par une cotisation volontaire approuvée par les membres.
- L’instauration d’une procédure lourde pour lever ces cotisations facultatives : obligation de convoquer une assemblée générale pour en présenter l’utilisation, délai minimal de 72 heures avant le vote, puis scrutin secret d’au moins 24 heures, et ce dans chaque unité d’accréditation visée. Chaque année, il faudrait répéter l’exercice pour renouveler l’autorisation, ce qui paralyse la réactivité des syndicats. Par exemple, si le gouvernement impose par décret une convention collective ou adopte une loi spéciale contre le droit de grève, le syndicat devrait suivre ce long processus avant de pouvoir financer une contestation judiciaire – une fenêtre d’action beaucoup trop lente pour être efficace.
- L’uniformisation forcée des statuts et règlements internes : le gouvernement se donne le pouvoir de définir par règlement le contenu minimal obligatoire des statuts syndicaux. Si un syndicat n’intègre pas toutes les clauses exigées, le règlement gouvernemental suppléera automatiquement aux dispositions manquantes, s’imposant comme les statuts officiels de l’organisation. Autrement dit, Québec pourrait dicter une partie des règles de fonctionnement interne des syndicats.
- Bref, sous couvert de transparence, le gouvernement surcharge le fonctionnement syndical avec des exigences bureaucratiques excessives, détournant des ressources précieuses vers la paperasse et menaçant de paralyser la démocratie syndicale par des contraintes administratives étouffantes.
Ce n’est pas de la « bonne gouvernance ». C’est une offensive antisyndicale et antidémocratique claire. Quand on tente de réduire au silence nos moyens d’expression, de pression et de contestation, on attaque l’un des derniers contre-pouvoirs vivants dans cette société : le pouvoir populaire organisé. Quand on s’attaque à une organisation syndicale, on s’attaque à tous ceux et celles qui comptent sur elle pour défendre leurs droits. Ne nous y trompons pas : affaiblir les syndicats, c’est nous renvoyer à l’isolement et à l’impuissance face aux puissants. Notre pouvoir d’action collective, construit à force de luttes, ne sera pas réduit au silence. Pas de bâillon pour les travailleur·euses !
Notre mobilisation du 29 novembre s’inscrit dans une longue et fière tradition de lutte ouvrière et populaire au Québec. Des ouvriers d’Asbestos en 1949 aux grévistes du Front commun de 1972, en passant par les centaines de milliers d’étudiant·es et de salarié·es dans la rue contre l’austérité en 2012, l’histoire nous l’enseigne : c’est par la grève et la rue que nous avons fait avancer nos droits.
Le moment est venu de passer à l’action. Face à ces attaques frontales, la solidarité est notre meilleure arme. Nous appelons toustes nos membres du SÉTUE, toustes les camarades de lutte et l’ensemble de la population solidaire à se joindre au front commun intersyndical du 29 novembre. Ce sera l’occasion de montrer notre force collective et de rappeler au gouvernement quelles sont les vraies priorités.
Rendez-vous à 13h30 à la Place du Canada à Montréal, aux côtés de milliers de travailleuses, de travailleurs et d’allié·es de partout au Québec.